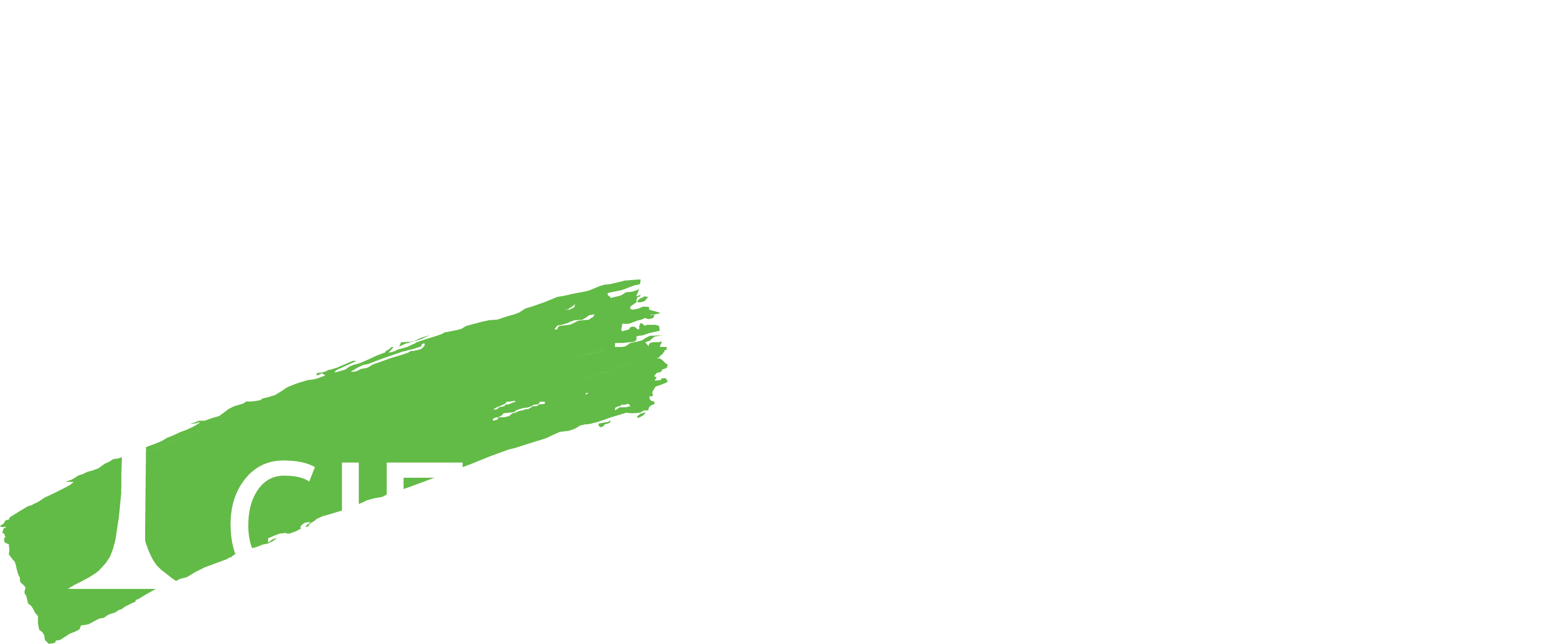En République démocratique du Congo (RDC), l’exploitation minière est un enjeu clé dans la double lutte pour la conservation des forêts et la protection des moyens de subsistance des personnes qui y vivent.
Il ne s’agit pas seulement des forêts abattues directement pour creuser la terre. Chaque hectare de déforestation causée par l’exploitation minière entraîne l’utilisation de 26 hectares supplémentaires pour la mise en place d’activités agricoles et de logements. Même si l’exploitation minière à l’échelle industrielle est souvent la plus préoccupante, son équivalence à l’échelle artisanale pose également problème pour l’environnement.
Dans l’est de la RDC, on recense près de 2 500 sites miniers artisanaux et 350 000 mineurs. De 2001 à 2020, ce sont 261 nouvelles mines qui ont vu le jour. Près de 32 % des familles de la région sont liées au secteur de l’exploitation minière artisanale. L’activité minière représente la principale source de revenus pour 59 % d’entre elles tandis que les 41 % restants l’utilisent en complément d’autres revenus.
« L’exploitation minière artisanale est une cause majeure de déforestation », a affirmé Malte Ladewig, doctorant à l’Université norvégienne des Sciences de la Vie (NMBU) à l’occasion d’un dialogue scientifique et politique de deux jours qui s’est tenu du 14 au 15 mars 2024.
« Et pourtant, cette activité est une source de revenus indispensables pour plusieurs millions de personnes dans l’est de la RDC, une région où les familles travaillant dans ce secteur sont moins susceptibles de souffrir d’insécurité alimentaire », a-t-il ajouté. « Il faut garder en tête toutes ces personnes dans la lutte contre les nombreux problèmes associés au secteur minier artisanal. »
Cette sixième et dernière édition d’une série de dialogues fait partie d’un projet sur la protection des forêts au regard de l’Étude comparative mondiale sur la REDD+ (GCS REDD+) dont la partie sur la RDC est dirigée conjointement par l’Université de Kinshasa (UNIKIN) et le Centre de Recherche Forestière Internationale et le Centre International de recherche en Agroforesterie (CIFOR-ICRAF).
Cet évènement hybride qui s’est déroulé en ligne et en personne a réuni des universitaires, des chercheurs, des fonctionnaires gouvernementaux, des donateurs, des acteurs de la société civile, des jeunes, des représentants du secteur privé et d’autres parties prenantes dans le but d’adapter la recherche aux besoins, politiques et objectifs du pays.
Carbone forestier et communautés
L’importance mondiale du patrimoine forestier de la RDC étant maintenant reconnue, le nombre de projets de REDD+ dans le pays a enregistré une forte hausse ces deux dernières années, passant de 18 en octobre 2022 à 27 en mars 2024. De plus, à mesure que ces projets se multiplient, il y a une prise de conscience croissante de l’importance de la participation communautaire.
« Les nouveaux projets font plus attention à ce que leurs documents incluent les communautés locales et les gouvernements en tant que parties prenantes ou partenaires », a relevé Stibniati Atmadja, scientifique au CIFOR-ICRAF, « et c’est une initiative qui doit être encouragée ».
Willy Loyombo, expert des questions de foresterie sociale et de REDD+, affirme toutefois que la prudence reste de mise. « Même si la mise en œuvre de la REDD+ et de son marché du carbone offre des opportunités de développement pour les communautés vivant dans les forêts », a-t-il prévenu, « elle présente dans le même temps un grand nombre de risques qui pourraient nier ou limiter leurs droits fonciers. »
Avant d’embarquer les communautés dans ces mécanismes complexes, Willy Loyombo estime qu’il faudrait réaliser des analyses rigoureuses. « La perte de l’accès aux ressources et la sédentarisation de l’agriculture réduisent la superficie des terres arables de ces communautés », a-t-il précisé.
« Même si les communautés ne sont pas expulsées, cela équivaut à de l’esclavage puisqu’elles vivent sur ces terres tout en étant soumises à un système qui les empêche de fréquenter certaines parties de leurs forêts et par-dessus tout, de planter leurs cultures dans les forêts primaires qui présentent pourtant un potentiel élevé en matière de rendement agricole. »
Orientations futures
André Kashikisha est intervenu au nom d’Augustin M. Mpoyi, conseiller technique principal au Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité (CODELT), indiquant que l’un des enjeux pour les futures politiques forestières en RDC consistera à garantir l’application d’un processus consultatif de qualité.
« Il faudrait élaborer et mettre en œuvre une méthodologie adaptée pour mobiliser les parties prenantes », a-t-il poursuivi. « En outre, les intérêts, les craintes, les contributions, les observations et les besoins des parties prenantes doivent être intégrés dans les politiques. »
Il a également soulevé la nécessité d’élaborer des outils pour faciliter la consultation et la collecte d’informations, ainsi que de veiller à ce que les commentaires sur des travaux comme les rapports de diagnostic et les projets de politiques, soient partagés avec les parties prenantes concernées.
« En tant qu’institution, l’État congolais fait face à plusieurs problèmes de taille pour subvenir aux besoins de sa population’ », a avancé Jérémie Abozo, conseiller juridique au rectorat de l’UNIKIN. « Le Congo dispose d’une vaste étendue de forêt, mais la RDC en tant que pays ne tire pas pleinement parti des bienfaits de ses forêts. »
Le projet du CIFOR-UNIKIN prenant fin, Robert Nasi, directeur des opérations du CIFOR-ICRAF, a déclaré que « ce qui compte c’est de réfléchir à l’avenir en regardant au-delà de cette étude, et d’examiner comment ce pays, qui abrite 60 % des forêts du bassin du Congo, peut continuer à jouer un rôle concret dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, tout en améliorant les conditions de vie de sa population. Et c’est cela le véritable enjeu : comment ménager la chèvre et le chou afin d’en tirer le meilleur ? »

Les participants du dialogue scientifique et politique. Photo prise par Ntina Munoki Anta et Lutho Lemisa Christian/CIFOR-ICRAF.
Nous vous autorisons à partager les contenus de Forests News/Nouvelles des forêts, qui font l’objet d’une licence Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Vous êtes donc libres de rediffuser nos contenus dans un but non commercial. Tout ce que nous vous demandons est d’indiquer vos sources (Crédit : Forests News ou Nouvelles des forêts) en donnant le lien vers l’article original concerné, de signaler si le texte a été modifié et de diffuser vos contributions avec la même licence Creative Commons. Il vous appartient toutefois d’avertir Forests News/Nouvelles des forêts si vous republiez, réimprimez ou réutilisez nos contenus en contactant forestsnews@cifor-icraf.org.